Après avoir longtemps préconisé le barrage-poids comme ceux du Crescent et de Chaumeçon, il fut adopté le principe de construction à contreforts, voûtes multiples et parois fine2. Moins cher, plus complexe et qui révèle la grande compétence de l'ingénieur. F. Cuq et son mentor A. Coyne6 dessinèrent les premières esquisses dans les années 1934-1936.
Des conditions essentielles pour ce type d'ouvrage : des appuis latéraux et une base rocheuse solides (cf. la douloureuse expérience de Malpasset11, des matériaux fiables. A cet emplacement le barrage devait s'appuyer sur le granite et F. Cuq connaissait son métier.
L'entreprise THEG emporta l'adjudication des travaux du barrage  (1 Mo) , en 1937.
(1 Mo) , en 1937.
l'entreprise Huguet celle de la totalité des ouvrages d'art en 1939 et d'une partie des routes en 1940.
Trois entreprises locales se partagèrent le reste des routes.
Le chantier s'installa, l'Yonne fut déviée et les batardeaux4 achevés, les travaux de terrassements (fouilles et creusement des fondations, etc.) furent pour moitié réalisés, la cité ouvrière construite, les échafaudages des ponts mis en place, les déviations et les chemins préparés.
Les gros travaux qui devait commencer au printemps-été 1939 prirent du retard et le chantier fut rattrapé ... par la guerre le 3 septembre 1939 !
Une partie des ouvriers fut mobilisée, il fallut gérer le flot des réfugiés, la "mise à l'abri" du matériel. Le chantier n'était pas complètement arrêté, mais dès l'automne 1940 il y eu des restrictions de gasoil et de ciment. Le Portland classique fut utilisé à défaut de disposer de "ciment de laitier de Crugey" ce qui expliqua, on l'ignorait à cette époque, les fissures et les gonflements constatés plus tard du fait de l'alcali-réaction5.
Et ce fut alors l'argent qui manqua. Les ouvriers mal payés quittèrent le chantier et ceux qui restèrent furent employés à des tâches subalternes et de conservation.
Les travaux furent arrêtés en mai 1942 par l'occupant, mais de toutes façon ils n'auraient pas pu se poursuivre dans cette précarité.
Pendant la guerre, du pillage eut lieu, qui n'était pas le fait des Allemands …! Par ailleurs, de "mystérieuses" disparitions, plus vertueuses celles-là, de petit matériel se produisirent comme ... des baraques de chantier (!!) mais tous savaient que le maquis de Chaumard avait quelques besoins et aucun gardien du chantier n'avait vu quoi que ce soit … sauf ceux qui partirent au maquis en cette occasion, évidemment … !
Après la guerre, en 1946, la priorité fut donnée aux ponts mais le ciment manquait toujours cruellement et le chantier du barrage proprement dit ne put commencer.
L'hiver 1947 fut polaire, dans la cité ouvrière c'était la misère (ravitaillement rare, chauffage difficile, salaires insuffisants, ...), le budget explosait. Il y avait 5 à 600 ouvriers sur le chantier, les ¾ étant de la région étant donné l'état des transports en commun16..
La sécurité sur le chantier était inexistante, mais malgré cela, les contreforts s'érigeaient, un mur parafouille de 4.5m sur 7 m de profondeur fut construit en amont à l'aplomb des contreforts et les voûtes elles même commencaient à monter18.
La mise en eau fut commencée le 31 décembre 1949 et le barrage fut rempli le 30 juin 1950..
Les travaux de finition comme la route sur la crête du barrage qui était prévue et passée sous silence, les travaux concernant le cimetière de Chaumard, etc. se sont fait avec le temps grâce surtout à la pugnacité des différents Maires..
C'est vrai que depuis Paris les priorités n'étaient pas évaluées de la même façon que sur place !
A partir de 1950, les fonctions de support d'étiage et d'écrêtement des crues purent être assurées.
Le coût de l'ouvrage avait été évalué à 48 millions de francs, il en coûta 762 (en assimilant la valeur du Franc avant et après la guerre, ce qui implique que ces valeurs ne soient que des ordres de grandeur) !



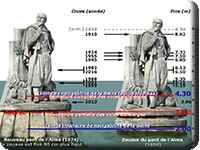





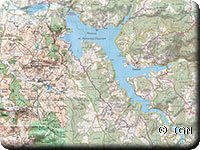



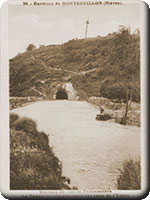
 (1 Mo) , en 1937.
(1 Mo) , en 1937.






