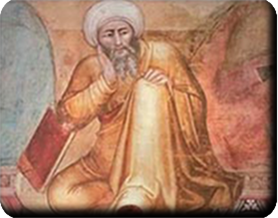Les centaines de milliers de pèlerins qui se rendent à Compostelle aujourd'hui le font à pied, pour des raisons spirituelles (54%), lors d'un pèlerinage religieux (38%) ou simplement par amour de la randonnée ou de l'exploit sportif (8%) (source : Oficina de Acogida del peregrino).
Mais lors de la "découverte" des reliques de Saint-Jacques et des siècles qui suivirent, ce n'était pas aussi évident.
Certains pèlerins animés par la foi prenaient la route pour offrir leur souffrance à Dieu pour leur rédemption et celle de leurs proches.
Ils choisissaient leur itinéraire en fonction des établissements religieux possédant des reliques sur lesquelles ils pouvaient prier, l'un pour faire libérer un ami (Saint-Léonard26), l'autre pour guérir d'une maladie de peau (Saint-Antoine) ; l'église favorisait beaucoup ce type de dévotion55.
Ils récupéraient une preuve de leur passage qui leur servait de sauf-conduit sur leur chemin (plus tard ce sera un crédentiel visé à chaque étape).
D'autres partaient participer à la reconquista, soit par idéal chrétien, soit parce que trop pauvres13 ils estimaient qu'ils n'avaient pas grand chose à perdre et qu'ils vivraient mieux comme soldat, avec la bénédiction de l'église.
Les uns et les autres prenaient la route, en cette période où les maladies étaient souvent incurables, où les forêts étaient peuplées de brigands n'hésitant pas à rançonner ou à tuer le voyageur, où les chemins étaient souvent impraticables, où le passage des ponts (quand ils existaient) et des rivières était payant, où les biaudes et les sandales en mauvais matériaux résistaient mal aux intempéries.
Ceux-là, qui n'étaient pas les centaines de milliers de la légende, méritaient le respect !
Mais il serait trop simple d'imaginer qu'il ait suffi de désigner Saint-Jacques en Galice pour que tout le monde prenne le bourdon14 !
L'église était toute puissante au xe siècle, toute faute, même civile était jugée à l'aune religieuse. Coupable ou non, le personnage incriminé était facilement condamné à faire le "pèlerinage" ou à partir en croisade car l'Église avait grand besoin de combattants.
Bien sûr, il y avait des Seigneurs-voyous qui se déplaçaient en carrosse ou payaient des miséreux pour marcher à leur place.
Ils n'avaient rien à envier aux vrais criminels condamnés à purger leur peine sur les chemins de Saint-Jacques, avec l'espoir de ne plus les revoir.
Enfin il y avait des "hérétiques" convertis ou non qui choisisaient de partir en pénitence sur le pèlerinage plutôt que d'être assassinés dans un cachot !
Tous en se croisant étaient absous de tout et pouvaient tuer et piller les musulmans en toute impunité.
Il y avait de tout sur les routes y compris des bandits de grands chemins qui parcouraient les campagnes vêtus en pèlerins. Ils détroussaient les voyageurs hébergés dans les Maisons-Dieu15 ou chez des hôtes charitables. Ils les dépouillaient au détour d'un bois ou les envoyaient directement "ad patres" sans état d'âme. Mais ceux-là n'allaient pas jusqu'en Galice !
A l'arrivée les "Jacquets" 14 était pris en charge par des moines qui les guidaient dans leurs dévotions, mais il y avait aussi à proximité des moines-soldats recruteurs pour les convaincre de s'enrôler et combattre l'Infidèle.
Comme lors des recrutements pour les croisades, le pape relayé par le clergé local leur promettait le pardon de leurs péchés à venir et le paradis s'ils mouraient.
Il faisait miroiter aussi la qualité de vie dans la péninsule et le droit de pillage en cas de victoire : le pauvre Morvandiau, à qui était promis l'aventure de sa vie s'imaginait revenir couvert de gloire et de respect, avec de l'argent qui sortirait définitivement sa famille de la misère, alors il s'engageait.